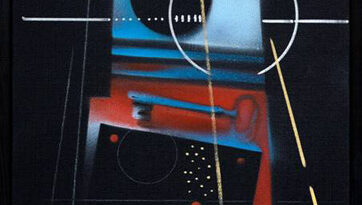L’atelier à ciel ouvert du sculpteur niçois Claude Giorgi
Claude Giorgi est né en 1954 à Nice, au nord de la ville, dans ce Vallon des fleurs qui serpente, long et étroit, entre les collines de Gairaut, de Scudéri et de Rimiez. C’était encore en 1954 une campagne maraîchère. Dans les années 60, une forte poussée immobilière a enserré les fermes dans un fatras faubourien d’habitations à loyer modéré, d’entrepôts et d\’équipements publics. Et en 1976, la maison de la famille Giorgi a été démolie pour laisser place aux hautes piles du viaduc de l\’autoroute qui enjambe le vallon.

Ce Tityre (1) niçois ne s’est pas exilé du pays de ses pères ; il ne s’est déplacé que de quelques mètres. Derrière un épais rideau de bambous, sa maison et son jardin-ateliers, flanqués d’un entrepôt souterrain, constituent une insolite campagne d’artiste retranchée de l’environnement urbain.
Ses grands-parents étaient métayers à Gairaut. Son père a été bijoutier à Cimiez avant d’entrer chez EDF. Sa mère, qui fut couturière, vit toujours au Vallon des fleurs et cultive son potager. A l’exception d’un grand-père venu de Toscane, le rayon d’action de la famille est court mais c’est pour mieux accumuler richesse d’expériences et de savoir-faire. C’est dans le giron familial que Claude Giorgi a appris le travail de la terre, les cycles de la nature, la maîtrise du feu électrique et des arts du métal.

Claude Giorgi est un autodidacte richement doté, possédant une connaissance innée de techniques complexes et de savoirs immémoriaux. Ce substrat familial a été encore enrichi par l’étude de la céramique et du bronze, par l’étude de la matière, terre et métal, à l’épreuve du feu.
C’est de façon naturelle et précoce que l’art s’est imposé dans sa vie. Dès l’âge de douze ans il profite des cours proposés par le comité d’entreprise d’EDF pour s’initier à la peinture. Au lycée professionnel des Eucalyptus, il a Michel Gaudet pour professeur de français. Peintre et fils de peintre, ayant grandi dans la bohème du Haut de Cagnes, critique d’art, Michel Gaudet axe alors volontiers son enseignement du français sur la découverte de l’oeuvre d’art et emmène ses élèves dans les musées.

Lorsque l’on pousse le portail du jardin, on est saisi par l’impression très forte de pénétrer dans un monde, dans un lieu total, qui rassemble dans un petit espace toutes les forces de l’univers. Tout est là : l’eau, la terre, le ciel et le feu.
Cette impression de cosmogonie ramassée sur quelques arpents de terre, je l’ai déjà ressentie une fois, lors de la visite dans les années 70 de la maison-atelier du peintre et céramiste Francis Crociani à Vallauris, où pots et sculptures de terre cuite, disséminés alentours dans le fouillis des végétaux participaient du cycle des saisons et du vieillissement du monde.
Claude Giorgi a revisité le traditionnel bassin d’arrosage niçois. Sous les arches qui supportent l’escalier d’entrée de la maison, des poissons nagent lentement dans un bassin-pièce d’eau architecturée. Trois tortues se cachent sous les feuilles du bananier. Sur un côté de la maison, l’établi de forgeron qui fut, au cours de son âge du fer, de 1994 à 2009, le théâtre de quinze ans d’assemblages et de soudures est toujours en place. Tout un fouillis suggestif de ferraille de récupération attend.

Des poissons métalliques s’accrochent aux branches des arbres. Ils datent de cet âge du fer. Ils sont faits de clous rouillés et de pièces de métal ou de plâtre du bleu vif de la haute mer. Ces squelettes de poissons aux long clous cillés semblent nager dans des posidonies terrestres.

Depuis qu’il a mis au point, en 2009-2010, sa technique de fonte unique, Giorgi travaille en plein air, tranquillement, à l’ombre du grand cerisier, lentus in umbra. Au sol, dans les herbes hautes, au milieu des agrumes, traînent des bruts de fonte comme autant de fruits métalliques.
Lui qui a travaillé pendant 35 ans dans des transformateurs d’EDF avec 200 000 volts se passionne pour les arts du métal dont il retrouve les techniques les plus archaïques.
Coulée à plat dans un moule ou coulée à la cire ou plus exactement à la matière perdue, les étapes sont nombreuses pour arriver au terme du processus original de fonte unique qu’il a mis au point. Tout s’organise autour de la clairière blanchie par le plâtre et de la ronde des moules cylindriques.

La première étape, la même depuis toujours, fer ou bronze, c’est le choix des objets. Il n’y a que les têtes de poisson (saint-pierre, mérou, sardine…) qui fassent l’objet d’une empreinte en résine. Pour le reste, ce sont les objets eux-mêmes, objets de récupération, qui une fois assemblés sont directement moulés dans le plâtre.
Il réunit des morceaux de bois, des bouts de ficelles, pièces de textile, déchets organiques, plumes, pattes de poulet, tout pourvu que ça se consume. Et ces assemblages de matériaux, pris dans la gangue de plâtre, sont installés dans le four pour une lente calcination de plusieurs jours. Lorsque toute matière a disparu, il coule à la place le bronze qui a été porté à l’état liquide dans une petite bonbonne.
Une fois récupérés les bruts de fonte, commence, assis sur un petit tabouret, le long et patient travail d\’ébardage, de ponçage, de polissage. Le terreau brun de la limaille se confond avec l’humus de la terre.

Claude Giorgi dispose à présent de tous les éléments de base en bronze qu’il va réorganiser, réassembler dans des compositions plus ou moins complexes au gré de sa fantaisie. Il assemble des matériaux et des objets comme on assemble des mots. Il dit, il raconte. Quelques derniers points de soudure et il peut, par un attentif travail de patine, mettre en couleur ses appareillages fantasques. Deux couleurs en perpétuel dialogue : un brun chaud et un bleu-vert tiède, terre et eau. Le travail tout pictural de la patine renforce la mise en lumière, la mise en espace de l’objet métallique et participe de sa métamorphose en récit.
Claude Giorgi ne façonne pas, ne modèle pas. A la création du dieu potier, il préfère le feu qui transmue des matériaux en oeuvre, qui transforme des objets en récit primitif.

Ce monde de perpétuelles métamorphoses et hybridations est un chaudron de farfadets. A l’inverse du philosophe Alain (2), son œuvre dit : « Nous ne savons pas ce qu’il y a dans les choses, mais nous avons découvert que les diables, lutins et farfadets y sont. »
Agnès de Maistre
- « Nos patriam fugimus ; tu, Tityre, lentus in umbra » « Les Bucoliques », Virgile
- (2) « Nous ne savons pas ce qu’il y a dans les choses, mais nous avons découvert que les diables, lutins et farfadets n’y sont pas » , Alain, « Propos », 1932