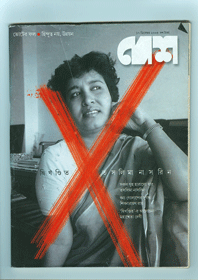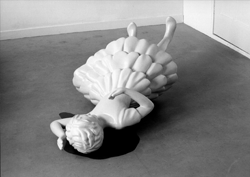Taslima Nasreen, le courage en exil
« Si l’Inde me tourne le dos, je n’aurai plus ni pays, ni foyer »
L’idéal serait de faire taire ceux qui veulent parler librement.
C’est peu dire qu’on s’y est employé à d’innombrables reprises. Des bûchers des sorcières aux bombes islamistes, c’est bien un idéal, celui des cimetières, de la terre brûlée, du grand silence, du grand silence sous l’œil de Dieu, le rêve enfin réalisé de l’abolition du temps, le rêve du garde à vous, de la prostration généralisée, de la mort enfin victorieuse. Viva la muerte, disaient-ils. On le dit encore. On le hurle, on le vocifère, ivre de haine et de frustration, de Djakarta à Gaza, dans la banlieue de Copenhague et à Hyde Park. Silence, on tue. Silence, on veut tuer encore. A Bombay, on tue en grand.
Ailleurs, plus correct, plus poli, plus cravaté, on crie moins fort. On murmure même. Avec des rondeurs d’évangéliste, on murmure le nom de Dieu pour appeler à des haines plus feutrées, on raisonne pour déboulonner Darwin, et certains, comme l’archevêque anglican Rowan Williams, amouraché de charia, songent à une Internationale d’un genre nouveau, une Internationale de la soutane et du hijab. Bras tendu, livre saint à la main. Gott mit uns, disaient-ils. Et si Dieu restait là où il est ?
C’est un des vœux que forme Taslima Nasreen, et peut-être le plus cher : Dieu, reste là où tu es ! Ne viens pas à Dacca où je suis persécutée, ne viens pas à Delhi où je suis enfermée, ne viens pas en Europe où je suis exilée. Ou alors délivre-moi du mal. Délivre-moi des fous d’Allah. Laisse-moi vivre. En apostat.
C’est un cri, un cri de détresse. Mais ceux qui ont lu la tribune dans Le Monde (12.01.08) de celle, chassée du Bengale, exilée à Delhi, à qui les autorités indiennes refusent d’octroyer la nationalité indienne ou même un titre de séjour de longue durée, le savent : si son inquiétude est grande de se savoir menacée de mort, le plus douloureux peut-être est d’avoir été l’objet de tant de lâcheté et de trahisons. « […] pas un seul parti politique de quelque obédience que ce soit n’a pris la parole en ma faveur, […] aucune ONG ni aucun groupe défendant les droits des femmes ou les droits de l’homme ne m’a soutenue, ni n’a condamné les attaques malveillantes lancées à mon encontre » s’écrie l’écrivaine bangladeshie.
Scandale.
Dans Rumeurs de haine déjà, la narratrice s’indignait que « ceux qui ne font ni les cinq prières quotidiennes, ni le ramadan, qui ne portent pas la barbe » lui tournent le dos. Elle précisait : « Je veux parler de ces encravatés qui se prétendent progressistes, de ces femmes soi-disant libérées et cultivées, et par-dessus le marché féministes depuis toujours, militantes encartées, qui lèvent les yeux au ciel en s’écriant : « Cette fille va trop loin ! »
C’est bien de le préciser. Comme pour la néerlandaise Ayaan Hirsi Ali, le dessinateur danois Kurt Westergaard, le journaliste afghan Sayed Perwiz Kambakhsh, Fawza Falih accusée de sorcellerie et condamnée à mort en Arabie Saoudite ou la jeune Iranienne Atefeh Rajabi pendue à une grue à l’âge de seize ans, et tant d’autres, bastonnés, mutilés, exécutés, la discrétion des progressistes est lourde de conséquences.
Sentiment de culpabilité à l’égard des ex-colonisés ? Incapacité à distinguer islamophobie et racisme ? Confusion entre masses populaires et hordes hystériques ? Connivences entre sectarismes ? Démagogie ? Mépris inconscient ? Il y a là matière à épiloguer. Sans oublier que c’est un gouvernement dirigé par les communistes du PCI (M) qui a censuré Taslima Nasreen avant de la chasser du Bengale.
Reste qu’une femme, écrivaine et militante, une femme qui veut être libre, libre de choisir, libre de sentir, libre de désirer, libre de parler, a besoin de notre solidarité et qu’il faut la lui accorder. Le « Prix Simone Beauvoir pour la liberté des femmes » qui lui a été accordé est un pas. Les tentatives de rassemblement ici et là – comme celle autour d’Ayaan Hirsi Ali – montrent la voie. Il faut aller plus loin.
Boualem Sansal, auteur du Village de l’allemand appelle « les pays occidentaux à faire barrage à un islamisme […] en évolution extraordinairement rapide […] susceptible de se transformer en fascisme de masse ». Des questions se posent : L’Islam peut-il s’accommoder de la modernité ? Un Islam non islamiste est-il possible ? Quel avenir pour les tribalismes ? La laïcité à la française est-elle en danger ? Peut-on faire confiance à l’Union Européenne pour défendre la séparation du religieux et du politique ? Faut-il se résigner à assouplir la laïcité et renoncer à la défendre et la faire progresser ? La religion peut-elle être une roue de secours de la politique, le supplément d’âme de la démocratie ? Faut-il craindre un retour de l’ordre moral ? Les thèses de Ron Hubbard valent-elles les Confessions de Saint-Augustin ?
Le courage sera d’y répondre, avec pour l’infâme la même intransigeance que Voltaire, dans la fidélité au Siècle des Lumières, sans céder sur aucuns fondamentaux d’une laïcité ferme et tolérante, en se souvenant, comme dit Bernard-Henri Lévy, que « la civilisation est un mince, très mince vernis ». Ou Alain Juppé : « La laïcité est le cœur de la République ».
Le 21 mai 2008, Taslima Nasreen a pu enfin recevoir, des mains de Rama Yade, Secrétaire d’Etat chargée des Affaires étrangères et des droits de l’Homme, le « Prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes ». C’était un début de réponse. Le 17 novembre 2008, elle était à Strasbourg, pour la présentation du recueil Huit nouvelles. « J’ai l’impression d’être debout à un arrêt de bus, attendant le bus qui me ramènera chez moi », disait-elle. Condamnée au Bangladesh à la prison par contumace, même le rêve de retourner en Inde est impossible.
Depuis, grâce à l’aide de la mairie de Paris, Taslima Nasreen a pu s’installer dans la résidence d’artistes du couvent des Récollets dans le Xe arrondissement. Le répit offert à une femme d’honneur est d’importance. Mais c’est aussi la France qui s’honore.
Pour Taslima Nasreen, la religion est l’ennemie du genre humain. Hors de la laïcité, point de salut. Lors de son dernier séjour en France, elle s’exprimait à ce sujet.
Vous pensez que la religion n’est qu’oppression pour les femmes, n’est-ce pas ? Le seul salut pour le monde musulman est dans la laïcité ?
Et aussi l’éducation. Elle doit être laïque parce qu’un enseignement imprégné de religion transforme les étudiants en fondamentalistes. Et je ne vois pas de différence entre religion et fondamentalisme.
Les lois doivent être basées sur l’égalité et la justice. Il ne doit y avoir qu’un seul code civil valable pour tous. Toute loi basée sur la religion est inacceptable parce que la religion opprime les femmes.
Comment se présente l’avenir au Bangladesh ?
Je ne vis plus au Bangladesh depuis longtemps mais la situation n’est pas bonne et empire même. Les fondamentalistes ont beaucoup accru leur influence depuis mon départ forcé. Parce que le gouvernement – quelque qu’il soit – encourage les fondamentalistes par pur intérêt politicien. Ce qui est très dangereux et très néfaste pour la société bangladeshie. C’est une vision à court terme pour se maintenir au pouvoir. Ils se servent de la religion pour tromper les ignorants.
On constate ailleurs aussi un réveil des fondamentalistes, aux Etats-Unis par exemple.
Oui, à cause des hommes politiques. Mais il y a aussi des causes internationales, comme la dislocation de l’URSS, etc. Les fondamentalistes en ont tiré argument pour prétendre que la religion n’était pas le bon moyen pour répondre aux besoins des gens et qu’il fallait renouer avec la religion. Après l’écroulement du communisme, ils ont présenté la religion comme la seule planche de salut. Secundo, il faut mentionner le soutien apporté par les Etats-Unis pendant longtemps aux fondamentalistes. Le résultat est que de nombreux musulmans modérés, au lieu de se tourner vers la laïcité, sont devenus des fanatiques.
Dans les pays arabes, il existait un fort courant nationaliste et laïque. Il a été remplacé par le mouvement islamiste. Au demeurant, la responsabilité des pays occidentaux est générale, sans parler de celle des intellectuels de gauche qui, au nom de la lutte contre le racisme et du droit des minorités, en arrive à prendre la défense de l’Islam et même de l’islamisme. Ce qui est une erreur dramatique.
Le seul moyen de protéger les minorités musulmanes est de critiquer l’Islam afin de permettre le multiculturalisme et l’exercice de l’esprit critique. Sans possibilité de critiquer, il n’y aura jamais de progrès du monde musulman et encore moins de laïcisation. Vous comprenez ? L’indulgence qu’on a en Occident pour l’Islam est mauvaise pour le monde musulman lui-même. Le relativisme culturel amène à excuser la torture au nom de la culture. Il faut au contraire encourager les mouvements laïques.
Non, vous ne faites pas assez. Et c’est une grave erreur que des progressistes ou des intellectuels se rangent, comme on le voit, du côté de l’Islam.
Le mot « féministe » n’a plus la même vogue en Europe…
Et pourtant les femmes européennes sont opprimées aussi. Elles ont beau bénéficier d’une bien plus grande liberté qu’il y a un siècle, les femmes européennes ne sont pas entièrement libres. Il existe une conspiration des hommes et du système pour briser l’unité des femmes, et prétendre que le mot « féminisme » signifie lesbianisme, haine des hommes, etc. Ce qui fait qu’un certain nombre de femmes se défie de ce mot.
Femme du Bangladesh, écrivaine, militante, comment concilier ces différentes identités ? Vous avez eu du mal à être reconnue en tant qu’écrivaine ?
Le problème, c’est surtout que je n’écris pas dans une langue européenne. J’écris en bengali et je dois donc être traduite. Mais même si j’ai d’abord été reconnue en Occident en tant que victime des islamistes, et militante rebelle, le fait que je ne sois pas blanche et que je vienne d’un pays pauvre ne m’empêche pas d’être reconnue en tant que qu’écrivaine. Beaucoup d’écrivains, en Inde par exemple, sont reconnus comme de grands écrivains. Et il y en a beaucoup aussi en Amérique latine. Mon combat en tant qu’écrivaine et militante est très respecté ici en Europe. Au Bengale d’ailleurs, je suis connue surtout en tant qu’écrivaine. Et c’est dommage évidemment que beaucoup se perde dans la traduction.
Il y a un lien entre le fait d’être médecin et écrivaine ?
Il n’y a pas de relation directe. Mais j’ai fait des études scientifiques et cela m’a aidé dans ma lutte contre la religion, contre l’irrationalité. Avant j’écrivais des ordonnances. Mais mon œuvre littéraire est aussi une sorte d’ordonnance pour la société, la société malade. Et mes poèmes, et mes essais. Je n’écris pas sur l’amour, etc. J’écris pour éveiller les gens. Je n’écris pas de fiction. La fiction est inutile.
Par Martin T.
Taslima Nasreen, De ma prison, Editions Philippe Rey, 2008
Taslima Nasreen (co-auteur), Huit nouvelles, Calmann-Lévy, 2008.
Légende : (c) Taslima Nasreen